
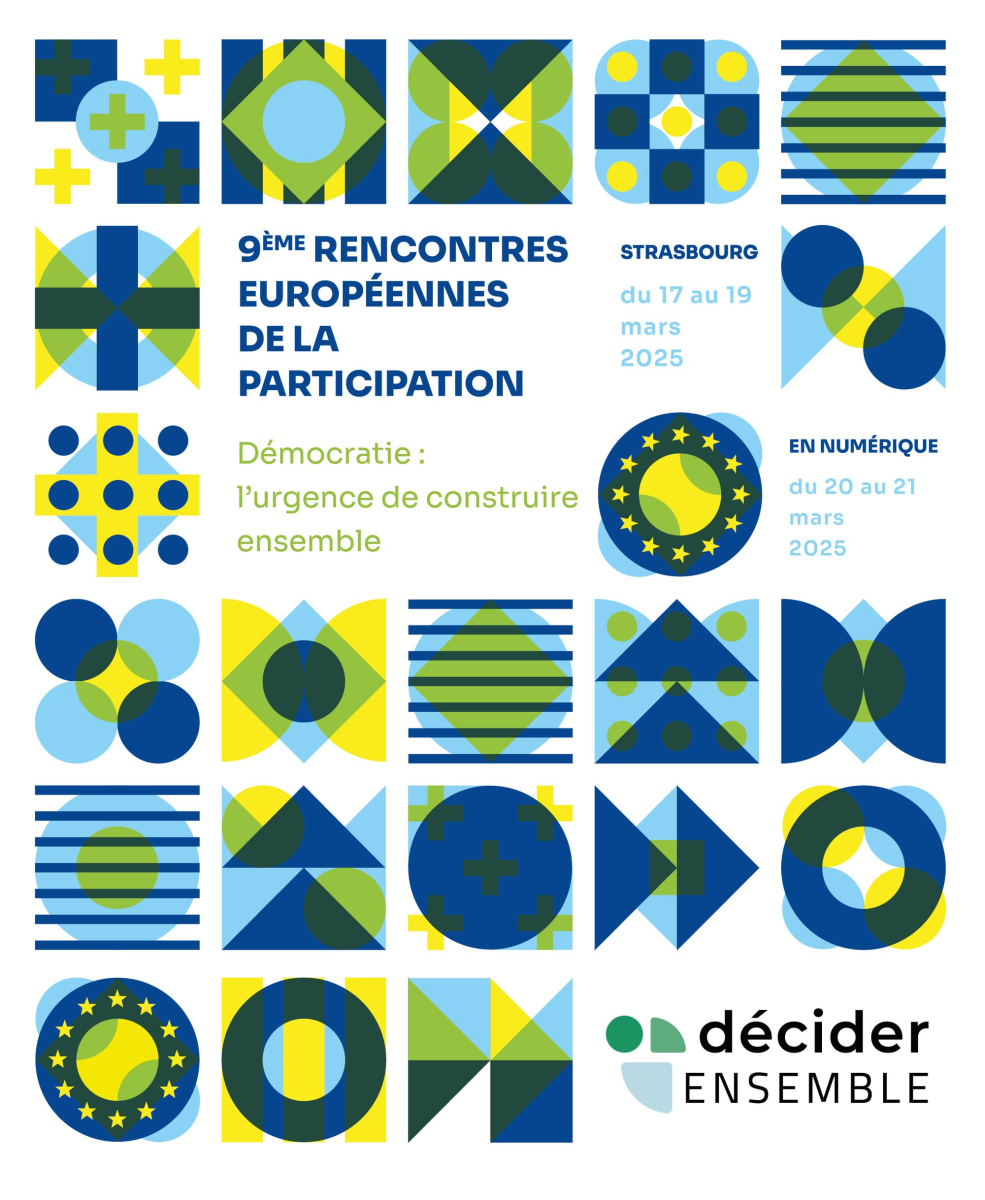 1800 participants étaient réunis en mars 2025 pour échanger sur les pratiques en matière de participation du public, et participer à des ateliers dont l’un était organisé par le Pôle participation du Cerema. Avec pour thème "Petite échelle mais grands enseignements : quand la participation n’est pas seulement l’apanage des grands", il a réuni des acteurs variés issus des collectivités, des entreprises impliquées dans des démarches de concertation, des associations, des chercheurs…
1800 participants étaient réunis en mars 2025 pour échanger sur les pratiques en matière de participation du public, et participer à des ateliers dont l’un était organisé par le Pôle participation du Cerema. Avec pour thème "Petite échelle mais grands enseignements : quand la participation n’est pas seulement l’apanage des grands", il a réuni des acteurs variés issus des collectivités, des entreprises impliquées dans des démarches de concertation, des associations, des chercheurs…
La participation : pourquoi, comment ?
Une première phase de l’atelier s’est déroulée en sous-groupes, pour identifier les leviers et défis dans la mise en œuvre de la participation citoyenne, en particulier dans des territoires de petite taille ou qui se sont récemment engagés dans la participation. Les participants ont d’abord défini leurs objectifs dans ces démarches participatives :
Cette première thématique a permis de dresser un bref panorama des pratiques, des objectifs et des réalités vécues par les différents acteurs impliqués en matière de participation citoyenne. La diversité des profils présents a mis en lumière des démarches portées à des échelles et dans des contextes très variés, mais animées par une volonté commune de faire participer et de faire évoluer les modes de gouvernance locale.
Les échanges ont montré un réel engagement des acteurs présents en faveur de projets plus ouverts et ancrés dans les territoires, en particulier face aux enjeux de transition écologique et de cohésion sociale. Les participants ont partagé de nombreuses initiatives inspirantes, mais aussi des difficultés bien réelles : manque de temps, de culture de la participation, obstacles à la mobilisation ou encore fragilité des moyens alloués…
Les freins
- Un manque de culture du débat public et de la participation citoyenne dans certaines collectivités ou chez certains élus,
- Une défiance croissante envers les processus participatifs, perçus comme des étant des "alibis",
- Des contraintes de temps et de moyens (manque de personnel, budgets limités, projets en simultané),
- Des publics cibles absents des concertations ou difficiles à mobiliser (jeunes sans moyens de mobilité ou en internat la semaine, populations précaires, habitants éloignés géographiquement…),
- La fracture numérique et les difficultés d’accès à l’information, en particulier pour les seniors ou les personnes en situation de précarité,
- Un sentiment d’épuisement des acteurs engagés, souvent confrontés à un manque de reconnaissance ou à un certain isolement,
- Des blocages politiques ou administratifs, avec des élus parfois réticents à partager le pouvoir de décision,
- Une sensation de manque de résultats, qui peut générer de la frustration et de la démobilisation.

Il peut y avoir des réticences, des craintes à voir plaquer des démarches menées dans la ville centre, à perdre son pouvoir de décision, où à ce qu'il n'y ait pas d'impact de la démarche. L'enjeu c'est d'embarquer petit à petit, de faire réfléchir à quel niveau d'association on veut mettre le curseur, et de chercher de la ressource en externe pour faire témoigner, qu'il y a pléthore d'outils et que les résultats peuvent être heureux.
Esther Fondelli avait également témoigné lors d’un Rendez-Vous mobilités du Cerema sur le thème "Mobilité locale : comment aller plus loin avec les habitants ?"
Une dynamique collective au service de la participation citoyenne locale
Aline Villière, Chargée de mission participation citoyenne et vie associative, à Saint-Barthélemy-d’Anjou (49), a présenté la démarche de structuration des processus de démocratie locale par la commune et la création d’un réseau départemental de praticiens de la participation.
Saint-Barthelemy d’Anjou a engagé en 2020 une réflexion sur ces démarches avec les élus, habitants et une association spécialisée. Celle-ci a abouti à la création d’un emploi pour une personne référente sur cette compétence dans la commune, et à co-construire un groupe de citoyens, un collectif de citoyens volontaires et tirés au sort appelé Le Rucher citoyen, en s’appuyant sur une charte de fonctionnement réfléchie avec les habitants.
A l’occasion d’une journée rassemblant des acteurs du département impliqué dans la participation citoyenne, l’idée de structurer un réseau de praticiens a émergé. C’est dans ce cadre qu’un groupe local du réseau de l’ICPC (Institut de la concertation et de la participation citoyenne) en Maine et Loire a été créé avec la participation d’Aline Villière, avec pour objectif de rompre l’isolement et la dispersion des professionnels du secteur, en favorisant le partage d’idées et de ressources.
Le Rucher citoyen peut se saisir de sujets impulsés par les citoyens, pour en discuter avec les élus. La démarche est vertueuse : elle favorise le rapprochement entre les élus, les équipes techniques et les citoyens à l’occasion de projets concrets comme la création de zones végétalisées. La proximité existante entre les citoyens et les élus représente aussi un levier d’échange et d’engagement : l’implication directe de certains élus dans les cafés citoyens, des actions de nettoyage à l’échelle de la commune ou encore le porte à porte pour recruter des membres du rucher a permis de donner du poids à la démarche.
Cette démarche montre qu’impliquer les citoyens nécessite du temps et de l’engagement de la part des élus. Les attentes, les temporalités entre l’action des citoyens et l’action politique et opérationnelle, peuvent être différentes : la participation se nourrit du temps long, de l’expérience, des expérimentations, et in fine d’une bonne compréhension entre les acteurs.
Quand une collectivité comme la nôtre choisit de recruter un(e) professionnel(le) de la participation citoyenne, celui-ci se retrouve souvent seul face au chantier à mener. C’est pourquoi, il est important voire nécessaire de créer une dynamique de réseau pour échanger sur ses pratiques, comme nous l’avons fait avec le réseau de l’ICPC (Institut de la concertation et de la participation citoyenne) en Maine et Loire.

Développer la participation à l’échelle d’une petite commune
Yann Feurté, conseiller municipal à Podensac (33), a expliqué comment la dynamique sur la participation des citoyens a été mise en œuvre dans cette commune où elle n’était jusqu’alors pas pratiquée. Yann Feurté a saisi l’occasion d’une journée de la citoyenneté qui devait avoir lieu dans la commune pour proposer d’impliquer les habitants dans l’organisation et l’animation (sur le thème sport et citoyenneté en relation avec les Jeux Olympiques).
 L’initiative, qui a impliqué un travail en collaboration avec un groupe d’habitants volontaires et les associations, a permis de mettre en place un programme riche avec plusieurs animations. En partant d’un objectif concret, cette expérience a inscrit la participation citoyenne dans les manières de faire pour les éditions suivantes, d’enrichir le programme et aussi d’apporter un budget supplémentaire. L’expérimentation du groupe citoyen a aussi été valorisée par un prix aux trophées de la participation et par l’obtention du label Terre de Jeux, permettant à des membres du groupe d’assister à la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques.
L’initiative, qui a impliqué un travail en collaboration avec un groupe d’habitants volontaires et les associations, a permis de mettre en place un programme riche avec plusieurs animations. En partant d’un objectif concret, cette expérience a inscrit la participation citoyenne dans les manières de faire pour les éditions suivantes, d’enrichir le programme et aussi d’apporter un budget supplémentaire. L’expérimentation du groupe citoyen a aussi été valorisée par un prix aux trophées de la participation et par l’obtention du label Terre de Jeux, permettant à des membres du groupe d’assister à la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques.
C’est en partant d’un objectif concret et en faisant appel aux méthodes participatives issues de son travail que Yann Feurté s’est mis en posture d’élu facilitateur pour mener à bien le projet, mené sans intervention externe.
L’adoption d’une “stratégie des petits pas” s’est révélée efficace dans ce contexte car elle a permis de commencer à l’échelle d’un événement pour rassurer, démontrer l’intérêt de cette démarche tout en créant une dynamique intéressante. La démarche de travail en commun a aussi renforcé les liens entre les acteurs du territoire.

Être élu ne veut pas dire être expert en tout. D’où l’importance de développer la participation citoyenne, même dans nos petites communes. L’apport des habitants et des habitants est précieux pour la réussite des projets. Le Festival de la citoyenneté à Podensac en est un bon exemple : nous sommes passés d’une vingtaine de participants à plus de 200, grâce à un programme riche, co-construits avec eux.
Le commentaire du Cerema :
Cet atelier sur la participation à petite échelle a mis en lumière la diversité des acteurs engagés dans la participation citoyenne et la richesse des expériences menées.
Si les objectifs poursuivis varient selon le contexte (création de lien social, transition écologique, amélioration de l’acceptabilité des projets...), tous traduisent une même volonté de faire évoluer les modes de gouvernance en impliquant davantage les citoyens.
Parmi les leviers identifiés, on retrouve :
- l’importance d’ancrer la participation dans des démarches concrètes et accessibles,
- la convivialité comme moteur d’engagement,
- la montée en compétence des acteurs (élus comme habitants).
Les freins, eux, sont bien connus : manque de temps, de culture de la participation, publics difficiles à mobiliser, ressources limitées, etc.


