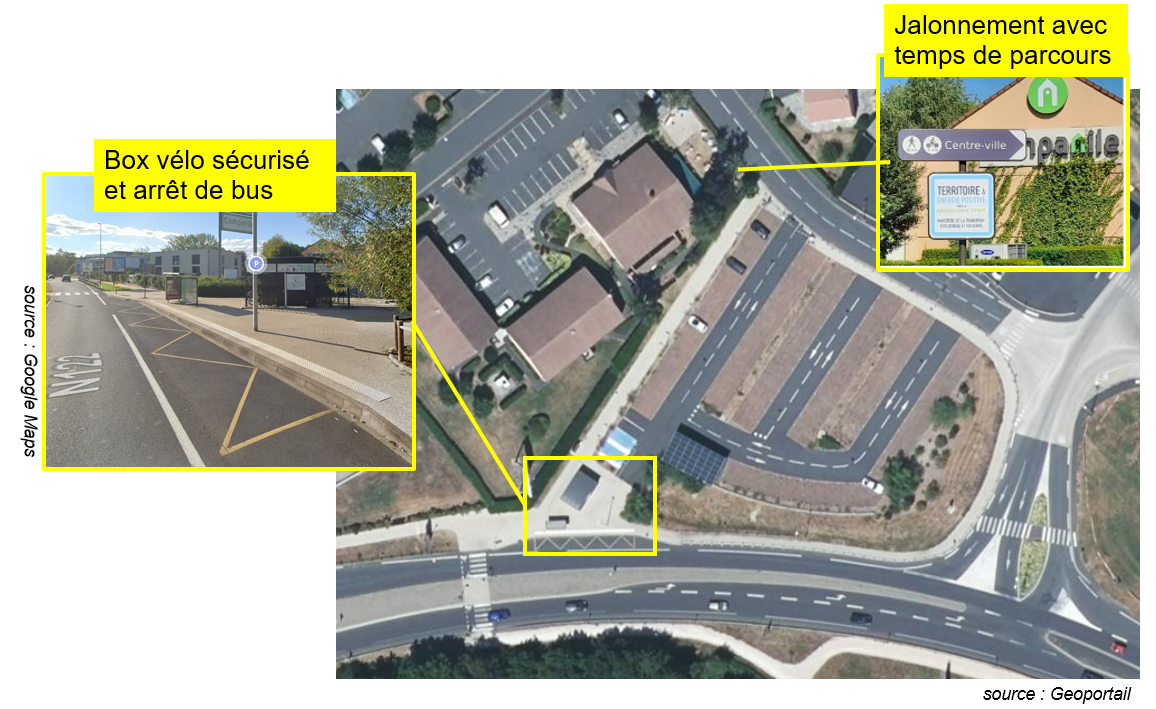S’il constitue un levier éminemment stratégique des politiques de mobilité et d’aménagement, le stationnement demeure un sujet particulièrement sensible voire polémique. En écho à cette dimension, il apparaît que les problématiques rencontrées en matière de stationnement souffrent d’un manque de connaissance qui nuit à l’engagement de politiques volontaristes : mieux connaître l’offre dans toutes ses dimensions, son fonctionnement, ses usages, la nature et l’origine des problèmes rencontrés ainsi que leurs impacts constitue alors un enjeu essentiel pour toute collectivité locale.
Un partenariat mené avec quatre villes pour les accompagner dans l’action
 Les villes de taille moyenne ne font pas exception à cette règle. Elles présentent en outre certaines spécificités qui, par rapport aux grandes villes, rendent plus délicate et plus complexe la conduite de politiques ambitieuses de réduction de la place accordée à la voiture en stationnement : des alternatives à la voiture particulière moins présentes et moins performantes, des habitudes de mobilité qui rendent plus difficiles l’introduction de contraintes à son usage ou encore une sensibilité accrue à la préservation de facilités de stationnement qui apparaissent notamment indispensables à la préservation de la vitalité commerciale ou résidentielle de centres-villes fragilisés.
Les villes de taille moyenne ne font pas exception à cette règle. Elles présentent en outre certaines spécificités qui, par rapport aux grandes villes, rendent plus délicate et plus complexe la conduite de politiques ambitieuses de réduction de la place accordée à la voiture en stationnement : des alternatives à la voiture particulière moins présentes et moins performantes, des habitudes de mobilité qui rendent plus difficiles l’introduction de contraintes à son usage ou encore une sensibilité accrue à la préservation de facilités de stationnement qui apparaissent notamment indispensables à la préservation de la vitalité commerciale ou résidentielle de centres-villes fragilisés.
Souvent confrontées à des situations où l’offre de stationnement peine à répondre à la demande, où le stationnement a envahi l’espace public au détriment d’autres fonctionnalités et d’autres usages, et où les nuisances qui en résultent sont patentes pour la ville et ses habitants, les villes moyennes ont néanmoins plusieurs bonnes raisons de mieux organiser et de réguler le stationnement automobile : offrir un cadre de vie plus accueillant et de meilleure qualité, valoriser les autres formes de mobilité ou encore optimiser l’utilisation des dispositifs de stationnement en lien avec les usages qu’on souhaite prioriser.
Pour aider à ce passage à l’acte, il est utile d’identifier les marges de manœuvre et les moyens d’action à la disposition de la collectivité. C’est la raison pour laquelle le Cerema Centre-Est a lancé en septembre 2023 un appel à partenariat intitulé "Expertisons le stationnement pour mieux l’organiser dans le cadre de politiques de mobilité et d’aménagement durables" auprès des communes de sa zone d’action. Il s’est concrétisé par un travail mené en 2024 avec les villes d’Aurillac, de Mâcon, de Riom et de Valence. Ce travail a permis de sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux et aux leviers des politiques de stationnement, et de tester des méthodes protéiformes de diagnostic terrain afin de mieux comprendre les dysfonctionnements et d’identifier des pistes d’action.
Des problématiques de stationnement diversifiées à l’interface des questions de mobilité et d’aménagement de l’espace public
Dans chacune de ces villes, l’objectif était d’apporter des réponses opérationnelles à un enjeu de stationnement spécifique identifié sur un secteur. Selon les cas, ces problématiques interrogeaient plus particulièrement la place de la voiture en stationnement sur l’espace public ou la régulation de l’accès à certains lieux et à certaines zones. Elles renvoyaient alors à différentes questions auxquelles les diagnostics terrain ont cherché à répondre :

Des diagnostics terrain combinant différents types de recueils de données pour connaître et comprendre
Pour répondre au mieux aux problématiques posées, des diagnostics terrain "flash" ont été menés par le Cerema en partenariat avec la collectivité. La conception des protocoles d’enquête terrain s’est faite sur la base des principes suivants :
- Dépasser une vision uniquement centrée sur l’offre de stationnement, cherchant simplement à savoir si son volume se révèle suffisant pour répondre à l’ensemble des demandes potentielles, pour adopter une approche fondée sur l’usage qui en est fait ;
- Rattacher autant que possible les pratiques de stationnement aux motifs de présence dans le secteur enquêté mais aussi aux lieux d’origine et de destination des automobilistes ;
- Comprendre la façon dont les pratiques se forgent, les logiques qui sont à l’œuvre, les besoins et les attentes qu’elles recouvrent, mais aussi les alternatives qui pourraient éventuellement être adoptées par les usagers.
Sur chaque site, le diagnostic terrain a ainsi donné lieu à une combinaison de plusieurs types d’enquêtes et de recueils de données : comptages et enquêtes quantitatives, enquêtes qualitatives sur le stationnement et auprès d’usagers de différents lieux, ou encore observations des pratiques et expertise des conditions de déplacements propres à différents modes.

Ces expérimentations ont conduit à mettre en exergue :
- L’importance de la connaissance qui peut être produite à partir d’un diagnostic terrain mené sur une seule journée, dès lors que le choix du jour et des horaires d’enquêtes a bien pris en compte la nature de la question à traiter ;
- L’intérêt de combiner des approches quantitatives permettant de mesurer certains phénomènes, comme l’occupation de l’offre de stationnement ou le type d’usagers occupant les places aux différentes heures de la journée, avec des approches plus qualitatives aidant à comprendre les pratiques et les facteurs qui en sont à l’origine ;
- La nécessité de réaliser des enquêtes et des recueils de données qui dépassent le cadre strict des questions de stationnement. Tout en abordant les questions de stationnement de manière spécifique et avec soin, les diagnostics terrain se sont intéressés plus largement aux questions de mobilités (piétonne, cycliste ou en transport en commun) et d’aménagement de l’espace public. Cette transversalité répond à la diversité des actions qui sont à même de répondre aux problèmes de stationnement posés aux collectivités.
Une aide à la décision qui a permis d’identifier divers leviers d’action
En aidant à mieux comprendre les problèmes et leurs causes, à identifier les dysfonctionnements et les pratiques qui en sont à l’origine mais aussi les opportunités et les pistes de progrès, les diagnostics terrain constituent de précieux outils d’aide à la décision, permettant de formuler des propositions d’action adaptées à chaque situation. En l’espèce, ils ont notamment permis d’identifier :